
Profil général
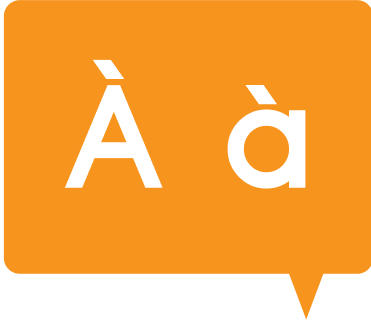
Culture et société

L’économie
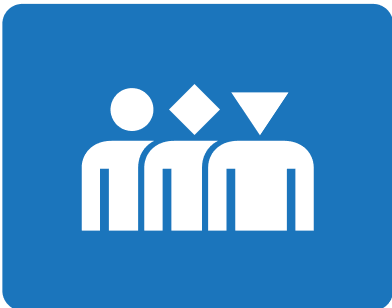
Immigration et diversité
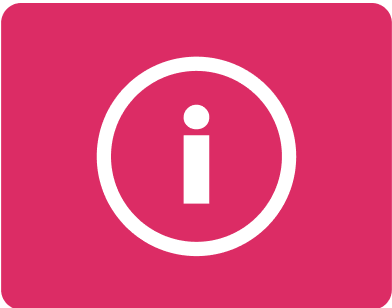
En savoir plus

Profil général
Foyer principal du français en Amérique du Nord et seul État francophone du continent, le Québec compte 9 millions de personnes en 2024 (Institut de la statistique du Québec), dont 8 millions parlent le français. La Charte de la langue française fait d’ailleurs du français la langue commune et la langue officielle du Québec. Au total, pas moins de 93 % des Québécois et des Québécoises parlent le français.
Plusieurs régions du Québec sont francophones à plus de 90 % : Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Gaspésie, etc.
La ville de Québec (549 450 habitants et habitantes), capitale et deuxième ville la plus populeuse, est francophone à 96 %.
La langue officielle de Montréal, métropole du Québec avec ses 1 762 949 habitants et habitantes, est le français et 71 % de la population y déclare le français comme première langue officielle parlée. Toutefois, l’immigration et la communauté anglophone se concentrent dans cette région.
L’Estrie et l’Outaouais comptent plusieurs localités bilingues.
Chiffres généraux sur la francophonie
- Population totale: 8 501 833*
- Nombre de personnes qui parlent le français : 7 879 255 en 2021
- Personnes ayant le français comme première langue officielle : 7 239 085
- Personnes ayant le français comme langue maternelle : 6 540 735
Source : Statistique Canada, recensement de 2021
* Population du Québec selon le recensement de 2021. L’Institut de la statistique du Québec estime la population québécoise à 9 millions de personnes en 2024.
Historique
Les premiers indices d’une présence autochtone remontent à environ 12 000 ans avant notre ère, en Estrie. Aujourd’hui, le Québec compte 11 nations autochtones, dont les Innus, les Hurons-Wendats, les Cris et les Inuits.
Jacques Cartier, navigateur français mandaté par le roi de France, explore le golfe du Saint-Laurent et atteint la Gaspésie en 1534. Samuel de Champlain fonde la ville de Québec en 1608, donnant naissance à la Nouvelle-France qui se développe avec la création d’établissements à Trois-Rivières (1634) et Montréal (1642).
Au terme de la guerre de Sept Ans (1756-1763), la Nouvelle-France est cédée à la Grande-Bretagne. Après l’indépendance des États-Unis d’Amérique (1776), des loyalistes se mêlent aux habitants du sud de la province. L’Acte constitutionnel de 1791 crée deux assemblées législatives, l’une majoritairement de langue anglaise (Haut-Canada) et l’autre majoritairement de langue française (Bas-Canada). Après les rébellions de 1837 et 1838 contre la Couronne britannique, menées en partie par des patriotes et nationalistes canadiens-français, Londres décide l’union du Bas-Canada et du Haut-Canada dans le but de mettre les francophones en minorité.
Les années qui suivent voient pourtant une explosion importante de la population québécoise francophone, grâce au taux de natalité des francophones, l’un des plus élevés au monde à l’époque : 50 naissances pour 1 000 personnes. À la faveur de cette « revanche des berceaux », Montréal retrouve sa majorité francophone en 1865.
Caractérisées par l’ascendant de l’Église catholique, la fin du 19e siècle et la première moitié du 20e voient pourtant la création de médias influents comme La Presse (1884) et Le Devoir (1910). Les femmes obtiennent le droit de vote en 1940, et le drapeau fleurdelysé est adopté comme emblème officiel du Québec en 1948.
La Révolution tranquille (décennies 1960-1970), période de vastes réformes et de rupture avec l’Église, coïncide avec l’essor du nationalisme québécois. Le français devient la langue officielle du Québec en 1974. La Charte de la langue française, adoptée 1977, étend la langue commune à toutes les dimensions de la vie en société. Deux référendums sur l’indépendance du Québec ont lieu en 1980 et 1995. La Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (2022) renforce la Charte.
Le Québec connaît plusieurs vagues d’immigration : les Juifs et les Italiens des années 1880-1920, les Européens après la Deuxième Guerre mondiale, des réfugiés du Chili, d’Asie du Sud-Est et d’Haïti dans les années 1970-1980, puis une immigration internationale plus variée. En 2021, plus de 14 % de la population du Québec était née à l’étranger.
(Sources : L’Encyclopédie canadienne, Statistique Canada)
Régions
Le Québec compte 17 régions administratives, subdivisées en municipalités régionales de comté (MRC), pour gérer les activités de l’État.
- L’Abitibi-Témiscamingue, où dominent l’agriculture, l’exploitation de la forêt et des mines, le secteur manufacturier, la chasse, la pêche et le tourisme.
- Le Bas-Saint-Laurent, région de ressources naturelles et de tourisme qui abrite aussi un secteur manufacturier ainsi que des institutions de haut savoir scientifique.
- La Capitale-Nationale englobe la ville de Québec, des localités avoisinantes au nord du fleuve Saint-Laurent ainsi que la région touristique de Charlevoix. C’est un pôle administratif, éducatif et culturel.
- La région du Centre-du-Québec, enclavée entre Chaudière-Appalaches, l’Estrie et la Montérégie, est à la fois agricole et industrielle.
- Dans Chaudière-Appalaches, au sud de la Capitale-Nationale, coexistent l’agriculture, une industrie forestière et un secteur manufacturier.
- La Côte-Nord, dans l’est du Québec au nord du fleuve, est un vaste territoire de forêts, de mines et de complexes énergétiques, royaume de la chasse et de la pêche.
- L’Estrie, prisée par les touristes, est aussi une région où se démarquent l’éducation universitaire et l’industrie agroalimentaire, avec une importante présence anglophone.
- La Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, à la pointe est du Québec sur les berges du golfe du Saint-Laurent, est une région axée sur la pêche, la transformation des ressources naturelles et le tourisme.
- Lanaudière est à cheval sur la vallée du Saint-Laurent et le paysage montagneux laurentien. Une région d’agriculture et de villégiature.
- La région des Laurentides, au nord de la région montréalaise, de longue date une destination récréotouristique.
- Laval est à la fois une région et la ville du même nom, sur une île (l’île Jésus) au nord de Montréal. La troisième ville la plus peuplée après Montréal et Québec.
- La Mauricie, dominée par la ville de Trois-Rivières, fut jadis la capitale mondiale du papier journal. L’industrie lourde y est encore présente, et on s’y déplace volontiers pour le plein air.
- La Montérégie, au sud de la région montréalaise, englobe des localités urbanisées, des sites industriels, des territoires agricoles, des destinations touristiques.
- Montréal, ville située sur l’île du même nom, est la métropole du Québec. Le pôle numéro un pour l’emploi, les services et la culture, avec un tissu social de plus en plus cosmopolite.
- Le Nord-du-Québec, au nord du 49e parallèle, englobe plus de la moitié du territoire québécois. Peu peuplée, exploitée pour sa forêt, ses ressources minières et l’hydroélectricité. Cris et Inuits y forment 60 % de la population.
- L’Outaouais, près de l’Ontario, a longtemps été une région dominée par l’industrie forestière. De plus en plus urbanisée, elle abrite aussi plusieurs localités bilingues, Gatineau au premier chef.
- Le Saguenay–Lac-Saint-Jean, vaste région qui doit son nom à une rivière et à un lac majestueux, est connue pour ses paysages naturels, mais compte aussi une activité industrielle importante.
Sources (2024) :
https://www.quebec.ca/gouvernement/portrait-quebec/geographie-territoire/regions-administratives
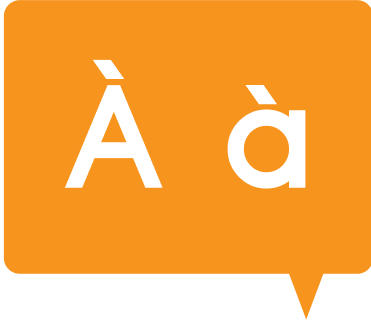
Culture et société
(Remarque : Ces données sont à titre indicatif. Elles ne sont ni classées par ordre d’importance ni exhaustives.)
Éducation
Au Québec, l’école secondaire se termine en 5e secondaire. Au cégep (acronyme de collège d’enseignement général et professionnel), les diplômés et diplômées du secondaire font deux années d’études préparatoires à l’université ou trois années d’études techniques. Dans les autres provinces canadiennes, l’enseignement primaire-secondaire compte 12 années et le cégep n’existe pas.
- Le Québec compte 61 centres de services scolaires, 9 commissions scolaires anglophones et 3 commissions scolaires à statut particulier, ce qui totalise 2 370 écoles publiques primaires et secondaires, 187 centres de formation professionnelle et 183 centres d’éducation des adultes.
- Le Québec compte aussi près de 270 écoles privées. Les deux tiers sont subventionnés par l’État, qui leur remet 60 % du montant normalement versé à l’école publique.
- 48 cégeps publics et 20 privés sont situés dans toutes les régions sauf le Nord-du-Québec.
- Le Québec compte 18 établissements universitaires, dont 5 universités autonomes francophones, l’Université de Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal (affiliées à l’Université de Montréal), l’Université Laval (à Québec) et l’Université de Sherbrooke, ainsi que le réseau de l’Université du Québec (9 établissements dans autant de villes).
Santé
Sous l’autorité du ministère de la Santé et des Services sociaux, la Régie de l’assurance maladie gère le réseau public.
- Les centres intégrés de santé et de services sociaux (CISSS) et les centres intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) assurent les services sur le territoire.
- Ces services sont offerts dans divers lieux physiques, notamment les cliniques médicales, les centres hospitaliers, les centres locaux de services communautaires (CLSC) et les centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD).
- Le secteur de la santé comprend aussi des établissements privés, par exemple des cliniques spécialisées et les résidences privées pour aînés (RPA). Les CHSLD sont tantôt publics, tantôt privés.
- Principaux hôpitaux au Québec :
- Centre hospitalier de l’Université de Montréal
- Centre universitaire de santé McGill (Montréal)
- Centre hospitalier universitaire Sainte-Justine (pour enfants, Montréal)
- Institut de Cardiologie de Montréal
- Hôpital général juif (Montréal)
- Centre hospitalier universitaire de Québec
- Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec
- Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke
Culture
Le secteur culturel québécois est dynamique et diversifié. Le Québec compte plus d’un millier de salles de spectacles, de musées, de centres d’artistes, de bibliothèques, de librairies, de cinémas, de stations de radio et de télévision, etc.
À Montréal, métropole culturelle, l’offre est généreuse. Quelques institutions particulières :
- La Place des Arts et le Quartier des spectacles, très prisés des Montréalais comme des touristes.
- Le Musée des beaux-arts de Montréal, fondé en 1860.
- TOHU, la Cité des arts du cirque : studios d’entraînement, de recherche et de création.
- L’Office national du film du Canada, producteur de films documentaires et d’animation.
- La Grande bibliothèque, la plus importante bibliothèque francophone des Amériques.
La ville de Québec, deuxième pôle culturel québécois, compte plus de 300 organismes culturels professionnels et amateurs. Parmi les plus connus :
- Le Musée national des beaux-arts de Québec, société d’État créée en 1983.
- Le Musée de la civilisation, spécialisé en sciences humaines et sociales.
- Le Grand Théâtre de Québec : salle de théâtre, de concerts et de danse, galerie d’art.
- L’Impérial Bell, salle de spectacle historique dans le quartier Saint-Roch.
- L’Institut canadien de Québec, fondé en 1848, gère le réseau de la Bibliothèque de Québec et la Maison de la littérature.
Les régions comptent aussi d’importantes institutions. Parmi elles :
- La Salle J.-Antonio-Thompson (Trois-Rivières), l’une des plus belles salles de spectacle au Canada.
- Le Centre culturel de Rimouski, qui rassemble sept organismes des arts de la scène et du patrimoine.
- La Maison de la culture de Gatineau, qui abrite une salle de spectacle et un centre d’exposition.
- La Salle Maurice-O’Bready (Sherbrooke), pour les spectacles en tous genres.
- Le Théâtre Gilles-Vigneault (Saint-Jérôme), adapté à toutes les disciplines des arts de la scène.
Il existe des centaines de festivals et événements culturels annuels au Québec.
Montréal, reconnue internationalement pour ses festivals, présente notamment :
- Le Festival international de jazz, depuis 1980.
- Les Francos de Montréal, festival international de chanson francophone.
- Le Festival international Nuits d’Afrique, dédié aux artistes d’origine africaine, antillaise et latino-américaine.
- Le Festival du nouveau cinéma, depuis 1971.
- OSHEAGA, festival musical sur les scènes extérieures de l’île Sainte-Hélène.
La ville de Québec offre plusieurs festivals, au gré des saisons :
- Le Festival d’été de Québec, spectacles musicaux extérieurs à grand déploiement.
- Les Grands Feux Loto-Québec, à Québec et à Lévis, spectacles extérieurs pyrotechniques et musicaux.
- Le Carnaval de Québec, en janvier-février, avec ses nombreuses activités extérieures pour toute la famille.
- Le Festival d’opéra de Québec, spécialisé dans l’art lyrique francophone.
- Québec en toutes lettres, festival littéraire thématique automnal.
Plusieurs festivals se tiennent aussi en région, par exemple :
- Le Festival de Lanaudière (Joliette), le plus important rendez-vous de la musique classique au Canada.
- Le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue (Rouyn-Noranda), qui fait rayonner le 7e art dans la région.
- Le Festival international Rythmes du Monde, qui rassemble des musiciens et musiciennes du monde entier sur les rives de la rivière Saguenay.
- Le Festival western de St-Tite, la plus importante célébration du genre dans l’est du Canada.
La culture québécoise s’exprime aussi sur les scènes de théâtre.
Parmi les nombreux théâtres de la ville de Montréal :
- Le Théâtre du Rideau Vert, la plus ancienne compagnie francophone active au Canada.
- Le Théâtre de Quat’Sous, depuis 1955.
- La compagnie Duceppe, dans la salle du même nom à la Place des Arts.
- Le Théâtre du Nouveau Monde, au cœur du Quartier des spectacles.
- L’Usine C, centre de création et de diffusion pluridisciplinaire.
Dans la ville de Québec :
- Le Trident, compagnie fondée en 1971, l’une des plus importantes au Québec.
- Ex Machina, compagnie multidisciplinaire qui possède son lieu de diffusion, Le Diamant.
- La Bordée, salle populaire située dans le quartier Saint-Roch.
Parmi les compagnies de théâtre fondées en région, en voici deux :
- Le Théâtre Les Amis de Chiffon (Chicoutimi), spécialisé dans les arts de la marionnette depuis 1974.
- Le Théâtre du Tandem, actif depuis 1997 à Rouyn-Noranda.
La scène musicale, notamment soutenue par l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), est particulièrement dynamique au Québec.
À Montréal, outre les festivals consacrés à la musique…
- La Place des Arts est une institution qui regroupe plusieurs salles et trois compagnies majeures :
- L’Orchestre symphonique de Montréal ;
- Les Grands Ballets canadiens ;
- et l’Opéra de Montréal.
- Dans le même registre, l’Orchestre métropolitain jouit d’une réputation internationale.
- Le Centre Bell, aréna de hockey, accueille d’imposants spectacles de musique populaire.
En plus de ses salles de spectacle multidisciplinaires, la ville de Québec abrite d’autres institutions et lieux de diffusion, dont :
- Le Palais Montcalm – Maison de la musique
- L’Orchestre symphonique de Québec, le plus ancien du genre en activité au Canada.
- Le Centre Vidéotron, aréna de hockey qui programme aussi des spectacles de musique populaire.
Les régions offrent également des événements musicaux majeurs, par exemple :
- Le Festival international de la chanson de Granby, inauguré en 1969.
- Les Grandes Fêtes TELUS (Rimouski), le plus important festival de musique à l’est de Québec.
- Le Festi Jazz Mont-Tremblant, qui offre des concerts gratuits en juillet-août.
La littérature du Québec et d’ailleurs est célébrée toute l’année lors de nombreux événements.
- Les principaux salons du livre au Québec se déroulent à Gatineau, Trois-Rivières, Québec, Sept-Îles, Jonquière, Sherbrooke, Rimouski, Montréal et en Abitibi-Témiscamingue.
- Les amateurs et amatrices de littérature convergent aussi au Festival Québec BD et au Festival BD de Montréal, au Festival littéraire international Metropolis bleu, au Festival international de la poésie (Trois-Rivières), au Festival international de la littérature (Montréal) et à Québec en toutes lettres.
- En 2021, le Québec comptait plus de 1 000 bibliothèques publiques. Plus de 96 % de la population bénéficie d’une bibliothèque dans sa municipalité.
Enfin, le Québec manifeste un goût particulier pour la danse classique, contemporaine et folklorique.
Le secteur de la danse est concentré à Montréal :
- Les Grands Ballets canadiens, compagnie fondée en 1957.
- Les Ballets Jazz Montréal, compagnie de danse contemporaine.
- La Compagnie Marie Chouinard, spécialisée dans la danse contemporaine.
- Des lieux de recherche, de création et de diffusion comme l’Agora de la danse, Danse Danse, La danse sur les routes du Québec, Danse Trad Québec, Tangente.
À souligner, dans la ville de Québec :
- La Rotonde, diffuseur spécialisé en danse contemporaine fondé en 1996.
- Le Réseau des veillées de danse au Québec, du Conseil québécois du patrimoine vivant.
Médias
Il existe neuf journaux quotidiens francophones au Québec :
- La Presse (Montréal)
- Le Devoir (Montréal)
- Les publications sœurs Le Journal de Montréal et Le Journal de Québec.
- Les journaux membres des Coops de l’information : Le Droit (Gatineau), Le Nouvelliste (Trois-Rivières), Le Quotidien (Saguenay), Le Soleil (Québec) et La Voix de l’Est (Granby).
En 2023, il y avait 91 journaux hebdomadaires au Québec, majoritairement gratuits, et 22 magazines francophones.
La télévision se décline en réseaux publics et privés, en chaînes généralistes et spécialisées, et en stations communautaires.
- ICI Radio-Canada Télé, télédiffuseur public généraliste basé à Montréal, exploite des stations à Québec, Rimouski, Rivière-du-Loup, Saguenay, Sherbrooke et Trois-Rivières, et diffuse des chaînes spécialisées : ICI ARTV, ICI Explora et ICI RDI.
- Groupe TVA, entreprise privée basée à Montréal, exploite le Réseau TVA avec ses stations de Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Rimouski-Matane-Sept-Îles, Saguenay–Lac-Saint-Jean, et quatre stations affiliées à Carleton, Gatineau, Rouyn-Noranda et Rivière-du-Loup. Groupe TVA diffuse aussi des chaînes spécialisées : ADDIK, CASA, Évasion, LCN, Moi et Cie, Prise 2, QUB, TVA Sports, TVA Sports 2, Zeste.
- L’entreprise privée Bell Média exploite la chaîne généraliste Noovo et ses chaînes spécialisées D, Investigation, Vie et Z. Bell Média possède aussi les chaînes spécialisées RDS et Super Écran.
- Télé-Québec est une chaîne publique éducative et culturelle.
- Il existe d’autres chaînes télé spécialisées, de moindre envergure, ainsi que 40 télédiffuseurs communautaires autonomes membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec.
En 1919, l’une des premières stations de radio au monde qui a diffusé selon un horaire régulier était située à Montréal. Aujourd’hui, les radios du Québec comptent :
- Les radios publiques ICI Radio-Canada Première et ICI Musique, basées à Montréal, qui diffusent aussi à partir de Matane, Québec, Rimouski, Rouyn-Noranda, Saguenay, Sept-Îles, Sherbrooke et Trois-Rivières.
- Une centaine de radios privées commerciales, 60 % d’entre elles appartenant à trois entreprises (Bell Média, Cogeco et Arsenal Media).
- 37 stations de radio communautaires indépendantes, membres de l’Association des radiodiffuseurs communautaires du Québec.
Organismes
Le Québec s’est doté d’institutions à son image dans tous les secteurs d’activité. Plusieurs organismes contribuent à la vitalité de la langue française, dont :
- Le ministère de la Langue française
- L’Office québécois de la langue française (OQLF)
- Le Centre de la francophonie des Amériques
- La Société Saint-Jean-Baptiste, Impératif français, le Mouvement Québec français, Partenaires pour un Québec français, le Mouvement national des Québécoises et des Québécois.
- L’Acfas
- Les nombreuses associations du secteur culturel, recensées sur le site web du ministère de la Culture et des Communications
- Le Trésor de la langue française au Québec (TLFQ)
- Les grandes centrales syndicales : la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ), la Confédération des syndicats nationaux (CSN), la Centrale des syndicats du Québec (CSQ), la Centrale des syndicats démocratiques (CSD) et d’autres.
- Le Conseil du patronat du Québec, Manufacturiers et Exportateurs du Québec, la Fédération des chambres de commerce du Québec et d’autres associations à vocation économique.
- Le réseau coopératif, notamment le Mouvement des caisses Desjardins.
- La Fédération des femmes du Québec
- Le réseau communautaire. Voir le site web du Réseau québécois de l’action communautaire autonome, qui représente plus de 4 500 organismes.

L’économie
Principales industries
En ordre décroissant de produit intérieur brut (PIB) : le secteur manufacturier, l’immobilier, la santé et les services sociaux, l’administration publique, les services professionnels, scientifiques et techniques ainsi que la construction.
Secteurs d’emploi
En ordre décroissant, les principaux employeurs au Québec sont le commerce de gros et de détail, la santé et les services sociaux, la fabrication, les services professionnels, scientifiques et techniques, le secteur de l’éducation, la construction et l’administration publique. Presque toutes les entreprises (97,7 %) du Québec comptent 99 employés ou moins.
Attraits économiques
Le taux de chômage, très bas au Québec, était de seulement 4,3 % en 2021. Cette année-là, on dénombrait plus de 238 000 postes vacants.
Organisme travaillant au développement économique
- Investissement Québec
- La Banque de développement du Canada
- La Fédération des chambres de commerce du Québec
- La Chambre de commerce du Montréal métropolitain
- Le Réseau Mentorat (anciennement Fondation de l’entrepreneurship)
- Centech (incubateur d’entreprises)
- HEC Montréal, école de commerce et d’administration affiliée à l’Université de Montréal.
Chiffres
Le PIB du Québec atteignait 468,9 milliards $ en 2021.
Le français était la langue de travail à près de 64 % au recensement de 2021, l’anglais seulement à 7,4 %, et les deux langues à 26,2 %.
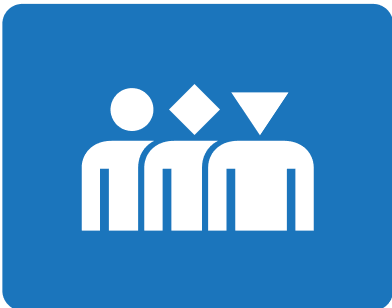
Immigration et diversité
La société québécoise
Le Québec est une société d’accueil et d’immigration qui valorise sa diversité et cherche à créer un environnement toujours plus inclusif.
En 2021, le tiers de la population de Montréal était né à l’étranger. La France est le pays natal du plus grand nombre d’immigrants et d’immigrantes, suivie par Haïti, l’Algérie, le Maroc, la Chine et l’Inde. Le nombre d’immigrants et d’immigrantes en région, qui augmente progressivement depuis 2001, a atteint des sommets au recensement de 2021.
Services d’accueil et d’établissement
Le Québec, contrairement aux autres provinces canadiennes, contrôle une part de son immigration grâce à une entente conclue en 1991 avec le gouvernement du Canada. La province favorise l’accueil de nouveaux arrivants et de nouvelles arrivantes francophones, et met en place des ressources pour la francisation ainsi que d’autres mesures.
Une centaine d’organismes communautaires offrent du soutien aux nouveaux arrivants et nouvelles arrivantes dans leurs démarches d’intégration au Québec. Le gouvernement du Québec tient à jour un répertoire de ces organismes.
Coût de la vie
Le PIB par habitant est faible comparativement à d’autres provinces canadiennes, mais une fiscalité progressive et plusieurs programmes sociaux particuliers (les garderies subventionnées, par exemple) rehaussent le niveau de vie jusqu’à égaler un voisin comme l’Ontario.
À quoi vous attendre
- Climat : La majeure partie de la population du Québec vit dans la vallée du Saint-Laurent, territoire aux changements de saison très marqués. L’hiver peut durer six mois. Le printemps est bref, l’été chaud. La province est réputée pour ses paysages automnaux très colorés. La température estivale peut dépasser 30 degrés dans plusieurs régions et les hivers sont assez froids à environ -10 degrés en moyenne. La température peut chuter ou s’élever de plusieurs degrés d’une journée à l’autre, peu importe la saison.
- Accès : Le plus important aéroport, l’Aéroport international Montréal-Trudeau, est situé à Montréal. Le réseau autoroutier relie le Québec à toutes les provinces canadiennes et aux États-Unis. VIA Rail exploite 110 gares au Québec.
- Transport : Le territoire est vaste et les villes peu denses, ce qui explique l’usage important de l’automobile. Montréal possède le service de transport en commun le plus développé (métro, autobus, train léger) et un réseau cycliste de plus en plus étendu.
- Infrastructures : La région de Montréal, où vit près de la moitié de la population, concentre les infrastructures clés, mais plusieurs villes en région sont dotées d’universités, d’hôpitaux spécialisés ainsi que d’équipements culturels, de loisirs ou touristiques.
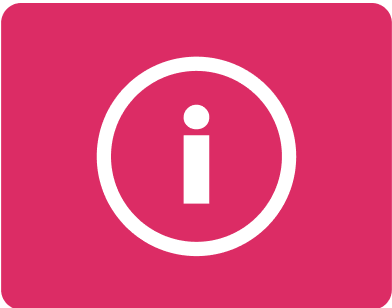
En savoir plus
Attractions touristiques à ne pas manquer
Plusieurs organismes et plateformes rassemblent de l’information sur le tourisme au Québec, au premier chef BonjourQuebec.com, vitrine officielle de la province. Voici quelques destinations particulièrement populaires.
À Montréal :
- Le Mont-Royal, l’oratoire Saint-Joseph et le Parc olympique sont les trois emblèmes de la ville.
- Tout l’été se succèdent de nombreux festivals : les Francos de Montréal, le Festival international de jazz, le Festival international Nuits d’Afrique et d’autres. Il existe aussi des festivals hivernaux, par exemple Montréal en lumière.
- Plusieurs musées sont prisés des touristes, notamment le Musée des beaux-arts de Montréal et Pointe-à-Callière, consacré à l’histoire et à l’archéologie de la ville.
- Le secteur de la restauration est particulièrement reconnu, tant pour la gastronomie que pour des plats traditionnels typiquement montréalais comme le bagel ou le sandwich à la viande fumée.
À Québec :
- Le Vieux-Québec est inscrit depuis 1985 sur la Liste du patrimoine mondial de l’UNESCO. Outre ses sites archéologiques et ses bâtiments de la Nouvelle-France, Québec est la seule ville en Amérique du Nord dont les fortifications demeurent presque intactes.
- Le Château Frontenac, hôtel de prestige construit entre 1892 et 1924, est une icône de la ville.
- Le Festival d’été de Québec est la principale attraction estivale, le Carnaval étant l’événement le plus populaire en hiver.
En région :
- Le tourisme de plein air est très présent, qu’il s’agisse de chasse et de pêche, de randonnée, de ski alpin ou de fond, de sports nautiques, de balades en traîneau à chiens, etc.
- La Sépaq (Société des établissements de plein air du Québec), société d’État qui gère des parcs nationaux, des réserves fauniques et des établissements touristiques, offre de l’hébergement ainsi que de nombreuses activités aux amateurs de plein air.
Personnalités qui ont marqué la francophonie
Un grand nombre de personnalités publiques ont contribué au développement et au rayonnement du Québec, et ce, dans tous les domaines. Consultez la liste de personnages historiques élaborée par le Conseil du patrimoine culturel du Québec ou la série documentaire de Télé-Québec 100 Québécois qui ont fait le XXe siècle.